À Madagascar, Andry Rajoelina, un président renversé
Mutins. « On a pris le pouvoir. La crise a assez duré, on va prendre nos responsabilités. » C’est par ces mots que celui dont il faudra retenir le nom a tourné une page dans l’histoire de la Grande île, celle d’Andry Rajoelina arrivé lui-même au pouvoir après un coup d’État en 2009. Ses responsabilités, le colonel Michael Randrianirina les a prises dès le samedi 11 octobre, alors qu’il descend sur la place du 13-Mai, cœur battant d’Antananarivo, pour rejoindre les manifestants, entouré des hommes du Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques, le Capsat. C’est le récit de ces heures de bascule que livre Emre Sari, le correspondant de Jeune Afrique.
Président Facebook. La journée du 13 octobre a été celle de la confusion autour du sort réservé au président vilipendé par la rue depuis le début des manifestations, en septembre. Selon une information de RFI, Andry Rajoelina aurait quitté le pays à bord d’un avion militaire mis à disposition par la France. Pourtant, toute la journée, il aura essayé de s’adresser à la nation pour assurer de sa présence, en vain… « Vers 22 h 30, enfin, son visage apparaît… mais uniquement dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook et sur celle de la présidence de Madagascar. […] L’adresse à la nation prend des tournures de banal « conf call », fissurant encore un peu plus la stature de celui qui se présente encore comme président en exercice. Elle finira de s’effondrer quelques heures plus tard », écrit le journaliste.
Et maintenant ? Validée par la Haute Cour constitutionnelle, la vacance du pouvoir est consommée, le colonel du Capsat est invité à exercer les fonctions de chef de l’État. Il va devoir répondre à des « interrogations majeures : combien de temps la transition va-t-elle durer ? Quand l’ordre constitutionnel sera-t-il rétabli ? Quelle sera la date des élections qui permettront aux Malgaches de voter pour leur président ? Le colonel a annoncé une transition de « deux ans maximum » sans que, pour l’heure, rien ne soit inscrit dans le marbre », laisse en suspens Emre Sari.
Au Cameroun, Tchiroma Bakary, un président autoproclamé
Affront. Un drapeau du Cameroun en arrière-plan et un portrait de lui en chef de l’État. Par cette mise en scène, Issa Tchiroma Bakary montre qu’ « il veut agir en qualité de président élu, sur le socle de ce qu’il considère comme la vérité des urnes », explique le correspondant de Jeune Afrique, Franck FOUTE. « Lorsqu’il a pris la parole dans la nuit du 13 au 14 octobre, […] l’ancien ministre et candidat à la présidentielle [est] conscient d’être scruté par un pouvoir qui l’attendait sur ce terrain. Le gouvernement et le parti au pouvoir avaient, bien avant le scrutin du 12 octobre, envisagé qu’un adversaire de Paul Biya pourrait se déclarer vainqueur en anticipant l’annonce officielle des résultats par Elecam », explique le journaliste.
Revival. Comme le souligne Franck Foute, un air de déjà-vu flotte à Yaoundé. En effet, il y a sept ans, lors de la précédente élection présidentielle, un autre opposant s’était déclaré vainqueur : Maurice Kamto. « Tchiroma n’a sûrement pas oublié l’épisode, lui qui figurait parmi les alliés du pouvoir, mobilisés pour faire bloc contre un Kamto isolé. Le ministre de la Communication d’alors avait qualifié l’opposant de « hors-la-loi ». » Mais cela permettra-t-il à Tchiroma d’éviter de vivre le même funeste destin que Maurice Kamto, qui n’était pas parvenu à faire valoir ses arguments devant le Conseil constitutionnel ?
Deux fronts. Face à cette situation, « le gouvernement et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir) organisent leur défense sur les deux fronts. Tout en rappelant l’incapacité du parti de Tchiroma Bakary à disposer des procès-verbaux de la totalité des bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire, le RDPC affiche sa sérénité et sa confiance envers le processus et le Conseil constitutionnel. Ses hommes au gouvernement, au premier rang desquels le ministre d’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, et celui de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, mettent également en garde contre toute tentative de contestation dans les rues », explique le correspondant de JA.
Comment Wagner a détourné des équipements des FAMa
Improvisation. L’Initiative mondiale contre la criminalité organisée (GI-TOC, pour « Global Initiative Against Organized Crime ») a publié une enquête, le 16 octobre, sur le détournement des stocks des Forces armées maliennes (FAMa). Matthieu Millecamps analyse le rapport qui démontre que « Wagner est arrivé sur le territoire malien sans l’intégralité des équipements nécessaires à une opération militaire. Ils ont donc dû « se procurer des armes localement, de manière improvisée », écrivent les chercheurs de GI-TOC. » Le matériel des FAMa constitue la source principale d’approvisionnement des mercenaires russes, une pratique qui a « contribué aux tensions qui sont apparues entre les FAMa et leurs membres de Wagner », note le journaliste de JA.
Violation du droit international. L’enquête de GI-TOC a pour « objectif, au-delà de mettre en lumière le détournement de moyens théoriquement alloués aux soldats maliens, de démontrer qu’en utilisant ces armes, les mercenaires russes ont contourné les règles du droit international qui encadre l’usage des équipements militaires ». En effet, « cette réattribution des équipements à un groupe paramilitaire s’est faite en violation de plusieurs traités internationaux. Le rapport cible en particulier les armes et équipements livrés par la France, le Nigeria, et la Chine, trois pays qui, comme le Mali, sont signataires du Traité sur le commerce des armes. »
Et de citer notamment « un traité entré en vigueur en 2014 sous l’égide de l’ONU sur le commerce international des armements conventionnels qui intime aux États l’obligation de s’assurer qu’il n’y a pas de « risque prépondérant » de voir les armes qu’ils livrent à des pays tiers être utilisées pour commettre des crimes de guerre ou contre des civils ».
Au Sénégal, la note de Moody’s relance la colère du secteur privé
Mauvaise note. La nouvelle dégradation de la notation du Sénégal par l’agence Moody’s enflamme les esprits, notamment chez les entrepreneurs et les investisseurs du secteur privé. « Alors qu’en février, elle avait déjà abaissé de deux crans la note souveraine du pays (passée de B1 à B3), l’agence a dégradé cette note, descendue à Caa1 et assortie d’une perspective négative », explique la rédaction économie de Jeune Afrique. Dès le lendemain, la mesure a été vivement critiquée par le ministère sénégalais des Finances, fustigeant une décision qui « ne reflète ni la réalité des fondamentaux économiques du pays ni les mesures de politique publique mises en œuvre pour consolider la stabilité budgétaire et renforcer la soutenabilité de la dette ».
Accord avec le FMI. Alors que le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté en août un « plan de redressement économique et social » devant être financé à « 90 % » par des ressources internes, la patronne du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a mis en avant le 15 octobre, en marge des assemblées annuelles d’automne de l’institution qui se tiennent cette semaine à Washington, « une rencontre productive avec le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba », assurant que les négociations sur un nouveau programme de soutien au pays sont « bien engagées » et devraient « se renforcer dans les prochaines semaines ».
Double peine. « Pour nombre de patrons, la décision de Moody’s est une inquiétude supplémentaire dans un contexte déjà tendu, le secteur privé redoutant, par ailleurs, les hausses d’impôts annoncées par l’exécutif », explique nos journalistes. « Le secteur privé sénégalais souffre. On parle beaucoup de la dette extérieure mais la dette intérieure, ce sont les entreprises qui sont au bord de la faillite. D’un côté, l’État ne paie pas ses factures ; de l’autre, il augmente les impôts. C’est la double peine », déplore un bailleur de fonds sollicité.
. Quelles économies africaines sont les plus dépendantes des mines ?
Constat. Jeune Afrique a lu « la septième édition du « Mining Contribution Index » publiée par l’International Council on Mining and Metals (ICMM), début octobre » et illustre ses conclusions en infographies pour démontrer que « sept des dix économies les plus dépendantes des mines dans le monde sont africaines ».
« En première position, la RDC domine sans partage. Forte de ses gisements de cobalt et de cuivre – deux minerais essentiels aux batteries électriques – le pays, qui fournit plus de 70 % du cobalt mondial, a vu la valeur de sa production atteindre près d’un tiers de son PIB en 2022. Derrière elle, le Mali (2e), le Zimbabwe (4e), la Mauritanie (5e), le Liberia (6e), le Burkina Faso (7e) et la Sierra Leone (8e) témoignent de la même dépendance. »
Minerais critiques. Un autre enseignement du rapport montre la ruée vers la bauxite qui s’est saisie du continent. « La Sierra Leone grimpe de 44 places, la Guinée de 28 », un bond qui s’explique parce que « les deux pays regorgent d’un autre minerai essentiel à la transition énergétique, la bauxite, dont est issu l’aluminium. Entre 2017 et 2022, les mines de bauxite se sont multipliées dans l’ouest de la Guinée, alors que le premier producteur du pays, la Société minière de Boké (SMB), a dopé ses capacités. La production nationale est alors passée de 51,7 à 103,5 millions de tonnes. »
JA





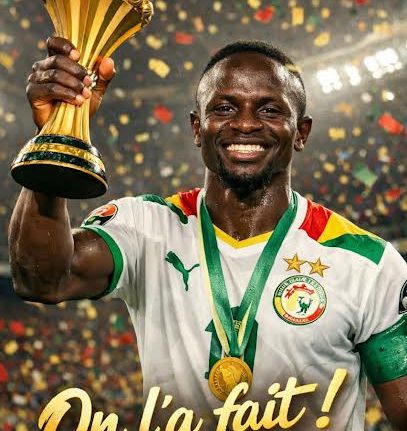


Leave feedback about this