Au Maroc, on célèbre la résolution de l’ONU, 50 ans après la Marche verte
50 ans de la Marche verte. Après le vote à l’ONU d’une résolution favorable à Rabat sur le dossier du Sahara occidental, c’est un anniversaire qui a un goût particulier. Le 6 novembre 1975, 350 000 Marocains entraient, à pied, dans ce qui était encore officiellement un territoire espagnol, afin de revendiquer la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental, rappelle Olivier Marbot. « Lorsque les historiens évoquent, même cinquante ans après, la Marche verte de novembre 1975, une expression revient presque systématiquement : un “coup de poker”. Soit une initiative intelligente et pacifique, couronnée de succès mais risquée. À la limite du coup de bluff », écrit le journaliste de Jeune Afrique.
« L’auteur de ce coup de poker, Hassan II, l’a lui-même admis dans une interview recueillie dix ans après la marche par Hamid Barrada, pour Jeune Afrique. “Si la Marche verte avait échoué, expliquait alors le souverain, j’avais décidé de quitter [le pays] (…) car je n’aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes.” »
« L’auteur de ce coup de poker, Hassan II, l’a lui-même admis dans une interview recueillie dix ans après la marche par Hamid Barrada, pour Jeune Afrique. “Si la Marche verte avait échoué, expliquait alors le souverain, j’avais décidé de quitter [le pays] (…) car je n’aurais plus eu le courage moral de regarder en face le moindre de mes sujets et de mes compatriotes.” »
Une nouvelle fête nationale. Quel plus beau cadeau pouvait espérer le royaume pour célébrer cet anniversaire que cette résolution onusienne favorable au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental ? Le roi a décidé de décréter, le 31 octobre, une nouvelle fête nationale : « une fête baptisée Aid Al Wahda (Fête de l’Unité), en référence à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale ». Cette fête sera « fédératrice pour l’expression de l’attachement aux sacralités » du royaume et « à ses droits légitimes », précise le communiqué. C’est la première fois que Mohammed VI instaure une fête nationale depuis son accession au trône, en 1999.
Le basculement du monde. La journaliste Fadwa Islah revient sur cette séquence entamée par le vote de la résolution 2797 de l’ONU. Dans un édito passionné, elle évoque ce « basculement diplomatique acté hors caméra : le plan d’autonomie marocain n’est plus une “simple” option, il est au cœur du dispositif de la résolution de ce conflit. Washington l’assume, Paris s’aligne, Tel-Aviv l’érige en victoire, Abou Dhabi en doctrine. Le monde ne commente plus la position du Maroc : il la reprend ».
Comprendre la crise du carburant qui paralyse le Mali
Pénurie. Cela fait plusieurs semaines que Bamako et d’autres villes du Mali sont confrontés à une pénurie de carburant. Derrière cette situation sans précédent, une nouvelle stratégie du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), qui s’en prend désormais aux convois pétroliers pour asphyxier l’économie malienne.
Ce qui pourrait bien fonctionner. Modibo Mao Makalou, économiste malien interrogé par Maher Hajbi et Aly Asmane Ascofaré, estime que la pénurie, si elle se poursuit, entraînera une inflation généralisée avec une hausse des prix de l’électricité, des transports, des produits alimentaires. L’activité industrielle risque, quant à elle, de tourner au ralenti. « Même le secteur informel, qui représente plus de 90 % de notre économie, sera impacté », ajoute-t-il.
Blocus. « Ce qu’il faut comprendre quand on parle de blocus, ce n’est pas qu’il s’agit de barrages permanents avec des panneaux “Personne ne passe”. Ce sont souvent une dizaine d’hommes à moto qui sèment la terreur sur un itinéraire, puis se replient. Dans ces conditions, il est difficile de les contrer efficacement, même par l’aviation : ils se fondent rapidement parmi les civils. Nous faisons face à de l’asymétrique », explique une source militaire à Jeune Afrique.
Marge de manœuvre. En l’absence des infrastructures pour stocker les hydrocarbures, Bamako s’appuie uniquement sur les camions-citernes, également appelés « pipelines roulants », qui assurent à la fois le transport et le stockage des produits pétroliers. Mais, toujours selon Modibo Mao Makalou, la junte au pouvoir va devoir, à court terme, diversifier ses voies d’approvisionnement et renforcer la sécurité sur les axes existants. À moyen terme, elle devra développer de véritables infrastructures de stockage au Mali ou dans les ports partenaires.
Aux confins du Sénégal
Dans cette série de trois reportages, Marième Soumaré est allée dans l’Est sénégalais, à la frontière avec le Mali.
Menace jihadiste. « Depuis que, en septembre, les hommes du Groupe de soutien de l’islam et des musulmans (Jnim), affilié à Al-Qaïda, ont décrété un blocus sur le Mali, les camions-citernes sont systématiquement attaqués », rappelle la journaliste qui plante le décor de cette frontière où les jihadistes n’hésitent pas à faire usage de la force. « Voilà plusieurs années que Dakar s’efforce de renforcer sa présence le long de la frontière avec le Mali » : blindés, nouvelle brigade de recherches, Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi) ou unité mobile chargée de patrouiller le long de la frontière, « les autorités sénégalaises ne prennent pas la menace à la légère [même] si elles se montrent réticentes à communiquer sur le danger qui rôde ».
Difficultés pour Pastef. Deuxième reportage dans « la région de Tambacounda, l’une des plus pauvres du Sénégal. [Ici], le taux de pauvreté est de 62 % contre 38 % au niveau national, et le taux d’alphabétisation plafonne à 39 % contre 63 % dans le reste du pays ». À partir de 2012, les quatre départements qui constituent la région ont tous voté pour Macky Sall et lors de la dernière présidentielle, c’est Amadou Ba [le candidat de l’APR] qui était arrivé en tête au premier tour. « Nous avons eu du mal à gagner du terrain », explique le responsable de Pastef dans la région. Dans de nombreuses communes, les patriotes peinent encore à toucher les électeurs et à « vendre » leur programme. Une situation qui pourrait s’expliquer par les logiques clientélistes qui, ici, ont la vie dure.
Système des castes. Enfin, Marième Soumaré interroge l’organisation sociale qui prévaut dans cette région encore très rurale et « où les traditions ont la vie dure, notamment le système de castes qui perpétue une organisation sociale qui assignait à chacun un rôle en fonction de son métier, lequel se transmettait dans la famille ». La journaliste a rencontré un conseiller municipal de Tambacounda qui insiste sur le fait qu’« aucune union ne peut être célébrée avant que soit menée une enquête rigoureuse sur l’ascendance de la personne qui doit rejoindre la famille ». Et de reconnaître que lui-même avait procédé à « ce type d’enquête pour ses propres enfants et pour ceux de plusieurs amis proches ».
Pourquoi le pétrole a encore de beaux jours devant lui en Afrique
À quand la date du pic pétrolier, ce moment où la demande mondiale d’or noir atteindra son apogée avant de décliner ? Aujourd’hui estimée à 104 millions de barils par jour (b/j), la demande mondiale de produits pétroliers devrait se maintenir jusqu’en 2040 avant de progressivement se contracter à l’horizon de 2050.
Démographie. Le journaliste de Jeune Afrique Maher Hajbi examine la question à l’aune des données du continent. « Sur les prochaines décennies, l’Afrique sera, à l’opposé des pays développés et de certaines économies émergentes, le principal moteur de la croissance démographique dans le monde », c’est pourquoi « malgré un contexte mondial de transition énergétique, la demande en produits pétroliers devrait augmenter, portée en grande partie par les besoins croissants d’une population africaine toujours plus nombreuse ».
Énergies vertes. « À l’heure où la baisse de la demande mondiale de produits pétroliers après 2040 se concrétisera, en partie, grâce à l’accroissement du parc de production renouvelable, le potentiel africain en énergies propres devrait rester largement sous-exploité », explique encore le journaliste. C’est ainsi que, « en l’absence d’un réel boom des énergies vertes, le règne de l’or noir se poursuivra en Afrique. »
Neutralité carbone. Même si, à l’horizon 2030, les investissements dans les projets pétroliers et gaziers devraient grimper pour atteindre environ 54 milliards de dollars, « la neutralité carbone est un horizon encore lointain pour le continent, qui reste en attente des financements des pays développés pour s’adapter au changement climatique et réussir sa transition énergétique ».
Comment le rift est en train de couper l’Afrique en deux
Incroyable. « On a tendance à imaginer le scénario catastrophe, à la Moïse, avec un gros tremblement de terre et l’eau de la mer Rouge et de l’océan Indien qui s’engouffre soudainement… Dans la réalité, on aboutira probablement à la séparation de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est par un bras de mer qui va se creuser peu à peu. » Scénario incroyable qu’explique la géophysicienne Christel Tiberi et que la journaliste à Jeune Afrique Maÿlis DUDOUET traduit en infographies. L’eau, d’ailleurs, est déjà là : les lacs Victoria, Tanganyika, Malawi et Manyara se sont formés grâce au rift – ou à cause de lui.
Fracture. Autrement dit, le continent est en train de se déchirer, lentement mais sûrement. Mais aussi, inexorablement : le cheminement du rift est-africain, cette fracture continentale de 4 000 kilomètres, est inarrêtable. À terme, la région où les plaques somalienne et africaine s’écartent progressivement l’une de l’autre va changer de visage. Les experts prédisent même l’ouverture potentielle d’un nouveau bassin océanique.
JM Source JA





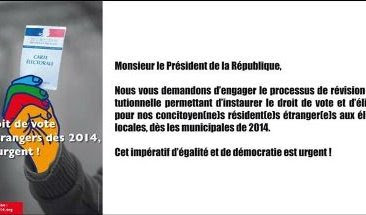



Leave feedback about this